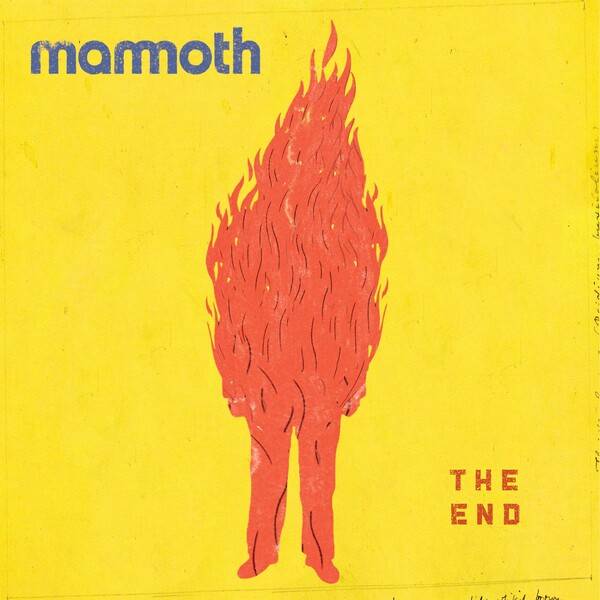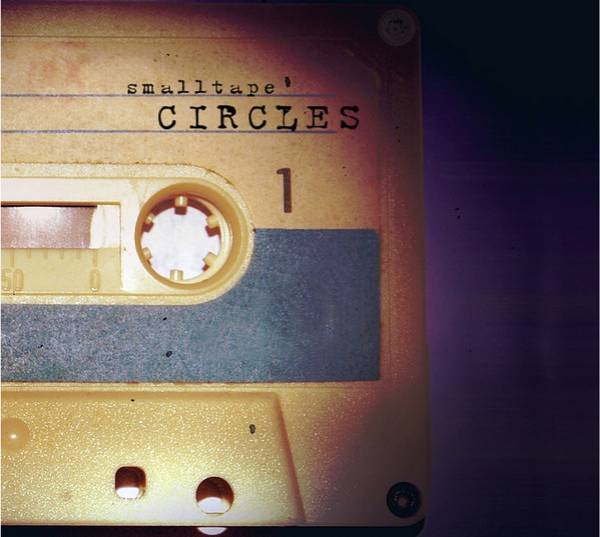Ranking albums – Deftones
Formation influente mais atypique dans le paysage metal, Deftones n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui : les plateformes de streaming affichent des chiffres colossaux, tandis que les stades se remplissent à un vitesse folle. On y croise toutes les tranches d’âge, des adolescents découvrant "Be Quiet and Drive" sur TikTok aux fans de la première heure. Parmi cette génération de groupes, combien subsistent encore aujourd’hui à ce degré d’importance et de qualité ?
Pour célébrer la sortie de Private Music ainsi que les trente ans de leur premier opus, albumrock vous propose un classement critique de cette discographie singulière. Celle-ci raconte autant l’histoire d’un groupe autodidacte, toujours soucieux d’affirmer sa différence, que celle d’un parcours jalonné d’excès et de tragédies.
La seule évidence, c’est qu’il existe de multiples façons de parcourir ce catalogue. La musique du groupe fait sans cesse dialoguer des univers a priori contradictoires, suscitant des réactions passionnées chez les auditeurs : ce classement ne peut donc être qu’éminemment subjectif. Chaque disque est néanmoins replacé dans le contexte de la carrière du groupe, afin d’aider le lecteur à établir sa propre hiérarchie – forcément différente de la nôtre.
Ranking
N°9 : Ohms (2020)

Cette dernière position surprendra sans doute, compte tenu de l’accueil très positif réservé à Ohms lors de sa sortie. Né d’une tentative de rapprochement entre les trois membres fondateurs après le désengagement de Carpenter sur Gore, ce neuvième disque se veut plus spontané, à la manière de Diamond Eyes qui avait revitalisé le groupe après l’accident de Chi Cheng.
L’intention paraît louable mais son exécution nous laisse perplexe : au-delà de quelques lignes de basse nerveuses ("Ceremony", "Radiant City"), Ohms s’enlise trop souvent dans une écriture convenue. Carpenter, jamais reconnu jusque-là pour sa polyvalence, tombe ici dans ses pires travers malgré un énième changement de matériel (neuf cordes), étant simplement incapable de surpasser son obsession pour les mêmes power chords qu’il recycle d’album en album depuis des années. Les choix et l’utilisation des synthétiseurs par Frank Delgado ne convainquent pas, et le groupe semble au final peu inspiré par ce qui ressemble à une régression stylistique. "Genesis" se place facilement parmi les ouvertures les moins convaincantes de leur discographie, faute de ligne mélodique ou de proposition sonore mémorable. On relève également une prestation globale étonnamment irritante pour les standards de Chino Moreno, dont le chant peine à trouver sa place lorsqu'il n’est pas dévoré par des effets sonores datés ou des textes fatigués ("I reject both sides of what I'm being told / I've seen right through / Now I watch how wild it gets / I finally achieve balance").
La réapparition du producteur historique du groupe Terry Date n’y change rien, puisqu’il échoue à mettre en valeur les dynamiques et les contrastes pourtant essentiels à la musique des Californiens. Avec son atmosphère dystopique et granuleuse qui aurait pu permettre au groupe de se réinventer doucement, Ohms reste écoutable mais souffre de la comparaison avec le reste du catalogue. Le morceau-titre en conclusion laisse entrevoir un regain d’intensité, mais le projet au global installe l’impression d’un groupe qui n’essaie plus de lutter contre ses mauvaises habitudes. On voit également un aveu d’échec à travers le fait que, malgré son plébiscite, l’album n’est presque pas joué en live, sans compter le retour du producteur de Diamond Eyes et Koi No Yokan pour Private Music.
À la suite de désaccords contractuels, Sergio Vega quitte son poste de bassiste peu après la sortie du disque, mettant fin à treize années de service. Son départ confirme alors le début d’une nouvelle ère pour Deftones, qui n’avait connu qu’un seul changement de personnel contraint depuis son premier album en 1995.
N°8 : Gore (2016)

Considéré par beaucoup comme le maillon faible de leur discographie, Gore arrive quatre ans après le succès critique et populaire de Koi No Yokan. Cette période difficile pour les musiciens conduit à un changement de style, surprenant mais finalement peu assumé ou mal maîtrisé. En parallèle des nouveaux projets solo de Chino Moreno (avec Crosses et Palms) puis de la réactivation de Team Sleep, le groupe décide de se lancer dans l’auto-production avec l’appui du technicien de studio de Koi No Yokan, et s’éparpille entre préoccupations techniques et expérimentations musicales. Carpenter, fragilisé par plusieurs épreuves personnelles, de la mort de Chi Cheng aux attentats de Paris, peine à s’investir dans le projet et ira même jusqu’à déclarer que son plus gros challenge sur l’enregistrement de Gore fut de se convaincre d’y participer.
L'album ose beaucoup de nouvelles choses, mais révèle alors un groupe déséquilibré, ayant perdu la mesure de ses forces. "Geometric Headdress" et "Pittura Infamante" s’étendent par exemple sur des riffs inédits pour le groupe qui semblent venir de Moreno, mais dont le jeu apparaît parfois limité par la mise en retrait de Carpenter. A l’inverse, les quelques bonnes idées ne sont pas autant développées qu’elles ne le pourraient, surtout à cause d’une production décevante, nettement en-deçà des prérequis du groupe à un tel niveau de longévité et de popularité : "Acid Hologram", le titre le plus fidèle au style de Carpenter, se voit presque gâché par une dynamique désastreuse, tandis que certaines parties de "(L)MIRL" manquent sérieusement de clarté.
Tout n’est pas à jeter dans Gore : il s’agit probablement de leur projet le plus sensible depuis l’accident de Chi Cheng en 2008. "Prayers/Triangles" évoque par exemple de sublimes nouveaux horizons avec son duo de guitares surréaliste. "Phantom Bride" (sur lequel figure un solo de guitare de Jerry Cantrell) s'abandonne à la mélancolie comme Deftones le fait trop rarement ces dernières années, avec un Chino mélodiquement brillant et une guitare bien plus expressive que d’habitude. On peut donc comprendre pourquoi certains restent attachés à l’album malgré sa réputation, puisqu’il fait briller une facette plus émotionnelle du groupe avec une ambiguïté sonore certes accidentelle, mais finalement assez rare dans leur parcours.
Même si le caractère conflictuel est souvent exagéré dans la relation Moreno/Carpenter (en dehors de l’époque White Pony) et que les talents de Deftones dépassent cette unique connexion, il est évident que les deux amis d’enfance sont les deux songwriters principaux depuis le départ et donc les responsables des différentes impulsions du groupe. Ici, le recul de l’influence du guitariste explique sans doute le manque de réalisme des compositions, mais ne suffit pas à enterrer l’album à lui-seul : la plus grande déception de Gore reste que sa qualité sonore ne soit que trop rarement à la hauteur de son ambition.
N°7 : Adrenaline (1995)

Sept années séparent les premières répétitions de Deftones et la sortie d’Adrenaline : l’album marque à la fois la fin d’un cycle et le vrai début de leur carrière – une transition qui porte naturellement son lot de contradictions. Les textes et les riffs régressifs de "7 words" ou "Engine No. 9" portés par la colère adolescente et le phrasé rap de Chino Moreno côtoient alors les sinistres "Bored", "Birthmark" et "Fist", dont les contrastes suggèrent l’identité que le groupe travaillera par la suite. En attendant, ce premier disque adopte un son brut et austère proche du post-hardcore de Drive Like Jehu ou Quicksand, qui permet d’endurcir les compositions les plus directes ("Nosebleed", "Root") au risque de rendre l’expérience globale plus monochromatique qu’elle ne devrait l’être. Cette production peine également à valoriser autre chose que la guitare incisive de Stephen Carpenter, alors que la section rythmique fascine déjà par sa singularité. Chi Cheng assure, en plus de la fonction de base de son instrument, une responsabilité atmosphérique, texturale, avec sa manière de remplir l’espace inspirée du dub et du reggae. Quant à Abe Cunningham, il rapporte déjà sa force de frappe puissante mais mesurée, son aisance rythmique, ses usages de caisse claire si particuliers.
Adrenaline reste traversé par ses influences – parfois trop évidentes (Bad Brains, Faith No More), parfois trop datées (Korn, Primus) – qui limitent encore l’affirmation d’une personnalité propre. Ce premier album porte donc les stigmates de son époque et trahit un certain manque de confiance, puisque le son est finalement assez typique des travaux précédents de Terry Date pour Pantera. Mais il compense par une énergie débordante qui le rend aujourd’hui bien plus écoutable qu’un bon nombre de ses concurrents, même au-delà de "7 Words" et "Engine no.9" qui sont un peu trop cités pour décrire le disque sans forcément représenter correctement l’ensemble. Pour l’apprécier, il faudra cependant ignorer certains textes (privilège francophone), dont la bêtise et l’insolence n'auraient pas fait tache sur les disques de Limp Bizkit à venir …
Œuvre de jeunesse inaboutie, Adrenaline esquisse, dans ses tensions et ses erreurs, les contours d’une formation qui marquera bientôt la grande histoire du metal. C’est aussi le point de départ du mouvement néo-metal (de pair avec le premier Korn), avec sa fusion agressive et instinctive de metal, de funk et de rap, ses guitares sous-accordées et ses chanteurs hyperactifs : pas le sous-genre du metal le plus fertile artistiquement, mais assurément celui qui le propulsera le plus haut commercialement, et celui que le groupe essaiera très rapidement de fuir.
N°6 : Deftones (2003)

Anxiogène et paranoïaque, ce quatrième album auto-nommé semble imprégné à la fois par le poids de son processus et par l’usure progressive de certains musiciens. Les Californiens se sont détachés avec grâce de l’étiquette néo-metal avec White Pony, et un nouveau monde rempli de possibilités s’ouvre désormais à eux. Mais le groupe entre en studio sans idées, fatigué des dernières tournées, peu enclin à reproduire les conflits de leur pièce maîtresse et dans l’illusion que l’inspiration viendra d’elle-même, comme pour ce dernier – oubliant au passage les différents blocages créatifs rencontrés pour celui-ci. Chino Moreno réalise ainsi brutalement que son attitude légère ne le mènera nulle part, alors que son couple se détériore, que son addiction à la cocaïne empire et qu’il a dû se faire opérer des cordes vocales en urgence peu de temps avant le début de l’écriture du disque.
Deftones passe huit mois en studio avec un Terry Date frustré, qui ne trouve pas toujours les bons mots pour faire avancer l’enregistrement. Moreno semble particulièrement démoralisé. Ses textes délaissent l’abstraction et le surréalisme de Around the Fur ou White Pony pour adresser plus directement ses difficultés du moment, avec une honnêteté parfois déconcertante. Le charme ou la séduction ne sont plus vraiment à l’ordre du jour, les mélodies semblent parfois désorientées dans cet univers musical opaque et accidenté : autant la faute de ses troubles que de la lassitude de ses collègues par rapport à son rythme de travail pachydermique.
Le disque écarte donc certaines composantes essentielles de la musique de Deftones et les remplace par une austérité pesante. Le principal inconvénient se situe du côté de la production, clairement un retour en arrière qualitatif par rapport à l’opus précédent, notamment ce mixage tacheté et nébuleux qui empêche l’album de respirer. Les compositions, elles, finissent par se mélanger dans cet étouffement. Ce basculement donne pourtant naissance à certains des titres les plus graves et touchants de leur catalogue : avec ses couplets dévastés et son chant désemparé, "Hexagram" n’a pas d’équivalent dans le registre agressif du groupe, tandis que la tristesse et la solitude épaisse de "Minerva" annoncent les influences shoegaze imposantes qui suivront.
En fin de tracklist, "Lucky You" et "Anniversary of an Uninteresting Event" invoquent à nouveau le trip-hop, jusque là seulement évoqué sur White Pony. Ces contrepoints texturaux sauvent alors l’album de la monotonie, mais pas de la morosité. Les bonnes idées de ce Deftones brillent finalement davantage isolées que noyées dans un disque dont la traversée reste laborieuse : il s’agit de manière évidente du disque le plus sombre et le plus oppressant de la formation californienne, tout comme leur première véritable marque d’essoufflement. Par ailleurs, les problèmes posés par l’élaboration de ce dernier amènent le groupe à se séparer de Terry Date pour la première fois, sans mesurer l’importance du producteur dans l’équilibre du groupe à cette saison de leur carrière.
N°5 : Koi No Yokan (2012)

Koi No Yokan arrive comme un tour d’honneur après leur retour triomphal de 2010. La satisfaction du groupe vis à vis de Diamond Eyes et des tournées qui ont suivi les ont rendu suffisamment confiants pour se lancer dans un projet un peu plus ambitieux. Le retour en studio se fait donc encore avec Nick Raskulinecz, mais aussi avec Sergio Vega à la basse, qui participe cette fois-ci entièrement au processus créatif. La collaboration avec le producteur continue d’être positive : Stephen Carpenter ose par exemple un changement de méthode en utilisant un simulateur d’ampli numérique au lieu de son équipement habituel, ce qui lui permet d’élargir sa palette sonore habituelle. À cause de ses autres engagements pour Rush (Like Clockwork) et Alice In Chains (The Devil put Dinosaurs Here), les Californiens voient finalement peu Raskulinecz durant le développement de Koi no Yokan, lui qui s’était pourtant impliqué lourdement dès les répétitions de l’album précédent.
Certains des titres les plus vigoureux se manifestent clairement comme des extensions de Diamond Eyes à la différence de la production : en plus des nouvelles textures liées aux équipements modernes, le son apparaît bien moins compressé dans les fréquences graves sans pour autant perdre de puissance. "Leathers" et "Poltergeist" fonctionnent très bien dans ce registre, mais on retient surtout de Koi No Yokan ses voyages nocturnes, contemplatifs et hypnotiques. L’album s’étend autour de ses deux pièces les plus longues, "Tempest" puis "Rosemary", qui oscillent toutes les deux entre post-metal et dream pop pendant plus de six minutes. Entre angoisse cosmique et sentimentalisme éthéré, le second morceau sort facilement du lot, quand "Entombed" brille de mille feux dans une toute autre galaxie, avec ses envolées miraculées et ses rythmiques synthétiques venues tout droit du projet électronique de Moreno, Crosses.
Au milieu de ces odyssées, "Gauze" dresse un pont élégant entre les moments les plus abstraits du disque et les démonstrations de force. Koi No Yokan souffre pourtant d’un songwriting inconsistant en dehors de son noyau dur, qui peine à retrouver l’efficacité de la première collaboration avec Raskulinecz – sans doute à cause de ses absences. "Goon squad" dure bien trop longtemps ; "Romantic Dreams" porte bien son nom avec ses transitions étranges, abruptes, presque absurdes ; les riffs simplistes de "Swerve City" fonctionnent en introduction du disque, mais finissent par ennuyer au fil des écoutes. Ces quelques longueurs restent largement supportables dans le contexte de l’album entier, et le manque d’éclat (relatif) se voit compensé par une atmosphère personnelle, plus cohérente et soignée que n’importe quel disque de Deftones au-delà de White Pony et jusqu’à Ohms. Ce septième album incarne alors un bon compromis entre la beauté chaotique de Saturday Night Wrist et l’urgence de Diamond Eyes, avec une production plus réfléchie qui gomme les quelques faux-pas de ce dernier et des expérimentations moins exigeantes que celles des années 2000. Le disque devient rapidement l’un des plus populaires du groupe grâce à ce statut intermédiaire, et plus largement grâce à ses structures progressives et au vertige de ses quelques chef-d’œuvres.
N°4 : Diamond Eyes (2010)

Avec leurs enregistrements très rapprochés dans le temps, Diamond Eyes et Koi No Yokan représentent un peu les deux côtés de la même pièce. Le chaos de Saturday Night Wrist dévie le groupe d’une trajectoire qui les poussait probablement à l’implosion et la création d’un nouveau disque nommé Eros commence. De nouveaux problèmes personnels interviennent mais font renaître les amitiés au lieu d’isoler certains membres du groupe comme par le passé. Il ne reste plus qu’à Chino Moreno de poser quelques voix lorsque Chi Cheng subit son terrible accident fin 2008, qui le plonge dans le coma. Le futur d’Eros et de Deftones demeure incertain pendant quelques mois jusqu’à ce que le groupe se retrouve pour discuter de la situation mi 2009. D’une manière presque miraculeuse, Diamond Eyes se termine en deux mois, sous la direction de Nick Raskulinecz et avec la première contribution de Sergio Vega, déjà habitué à aider le groupe depuis la fin des nineties.
Le nouveau producteur s’implique beaucoup plus dans l’écriture que les précédents, avec l’ambition de valoriser les bonnes impulsions plutôt que les discussions cérébrales et les architectures complexes. L’immédiateté et la cohésion deviennent plus importants que les autres aspects, pour la première fois depuis Around The Fur, sans pour autant explorer les mêmes idées de colère et de frustration. Le morceau-titre placé en introduction résume très bien ce changement de paradigme, avec ses textures sous haute pesanteur, matinées de souplesse. Malgré l’état inquiétant de Chi Cheng, on trouve de la beauté et de l’optimisme dans ce Diamond Eyes qui pratique les contrastes familiers de Deftones à travers des images d’éther, de puissance et de sexualité. Le plaisir de Carpenter dans cet exercice se voit clairement à travers les démonstrations de force de "Royal", "Rocket Skates" et surtout "You’ve Seen The Butcher", dont les riffs menaçants respirent une confiance inespérée après son manque d’entrain sur l’album précédent.
Le groupe retrouve plus largement une forme et une aisance qu’il n’a pas connue depuis le début de la décennie précédente. En particulier, Chino Moreno épouse une seconde jeunesse en se débarrassant de ses problèmes de drogues, avec des performances saisissantes dans tous les registres déployés, qu’ils soient agressifs ("CMND/CTRL") ou plus subtils ("Risk"). Loin d’être le plus aventureux de cette discographie, l’album ouvre malgré tout la voie à quelques petites transformations, avec les influences dream pop persistantes de Saturday Night Wrist qui donnent lieu à au moins deux douceurs inestimables, "Beauty School" et "Sextape". En plus de briller par leurs singularités, ces deux titres séduisent par une qualité sonore qu’on peine malheureusement à trouver sur le projet entier.
Diamond Eyes n’est pas un retour aux sources, mais une renaissance artistique salutaire dans un contexte pourtant dramatique. Ce sixième album relance complètement la carrière de Deftones – déjà en les faisant découvrir à une nouvelle génération d’auditeurs, mais avant tout en reconnectant les membres du groupe avec leurs passions et leurs ambitions. Il faudra cependant attendre Koi No Yokan pour retrouver le goût de l’aventure dans la musique du groupe.
Chronique complète à lire ici.
N°3 : Saturday Night Wrist (2006)

Sous la pression du label et dans un bouleversement personnel qui isole Moreno, Saturday Night Wrist ressemble davantage à un collage d’idées inachevées qu’à un projet collectif conscient. Le label Maverick force les Californiens à retourner en studio rapidement pour fournir un successeur au disque auto-titré dans de plus brefs délais. Vu le manque d’efficacité du dernier cycle, un nouveau producteur est débauché : Bob Ezrin (Pink Floyd, Alice Cooper, Kiss, Jane’s Addiction). Le vétéran apporte le cadre exigeant demandé mais brusque souvent les musiciens au-delà de leurs seuils de tolérance, en particulier Chino Moreno, autant à cause d’une connexion créative inexistante que du chaos de sa vie privée, entre drogues, tromperies puis divorce. Le chanteur finira simplement par quitter le studio pour aller jouer avec Team Sleep pendant six mois, sans donner de nouvelles à ses camarades de Deftones, qui envisagent alors de le faire remplacer.
Alors que le résultat final devrait logiquement lorgner vers la catastrophe, ce cinquième album contient certains des plus beaux moments du groupe depuis White Pony, notamment grâce ses influences shoegaze poussées à l’extrême au détriment de quelques réflexes metal qui commençaient à devenir invasifs. "Hole in The Earth" introduit superbement l’album avec son rythme insaisissable, ses guitares épaisses et chaleureuses, et surtout son langage dramatique, qui traduit le péril imminent du groupe en accident planétaire. Saturday Night Wrist explore ensuite une houle de lumières souterraines, artificielles, noyées, qui donne au projet une texture hostile et ambiguë, mais inévitablement attirante. "Beware" puise dans le déchirement de l’album précédent pour en faire une sublime fable morbide. "Cherry Waves", qui est devenu l’un des titres les plus populaires de leur répertoire sur les plateformes de streaming, contient probablement la meilleure ligne de basse de Chi Cheng tout comme l’un des meilleurs refrains jamais chanté par Chino Moreno, avec cet écho poly-forme transperçant, simplement inoubliable. Plus loin, "Kimdracula" et "Combat" réussissent à donner l’illusion d’un collectif soudé, déterminé, débordant d’énergie, malgré tout ce que l’on sait. "Riviere" conclut l’expérience avec un dernier plongeon dans la mélancolie, et un dernier refrain marquant pour un disque qui les aligne naturellement.
Il faudrait des dizaines de pages pour retracer avec justesse les événements surréalistes qui ont mené à la presque inexistence de ce disque, dans un climat chaotique qui a vu le groupe éclater en morceaux avant de se reconstruire miraculeusement. Avec sa construction expérimentale et sa finition presque expéditive, Saturday Night Wrist n’est évidemment pas un projet parfait. L’instrumental "Pink Cellphone" devient l’un des pires titres de leur carrière lorsque cet épouvantable monologue refuse de se terminer. Autre fait remarquable, le timbre de voix de Moreno s’amincit en conséquence de sa prise de substances : "Rapture" fait presque de la pleine lorsque l’on se souvient de ses exploits passés. Mais l’album compense largement les différentes erreurs de parcours dans ses vapeurs épaisses, ses mélodies universelles et son atmosphère unique, pesante, magnétique, irrésistible. Indiscutablement l’élément le plus sous-estimé de leur discographie.
N°2 : Around The Fur (1997)

Agressif, immédiat, grave, anxieux : Around The Fur symbolise à lui seul l’essence du néo-metal, détachée des mauvaises manières qui colleront ensuite au genre. Adrenaline ne montrait que partiellement ce que Deftones pouvait incarner musicalement, puisque le collectif n’avait alors pas l’assurance nécessaire pour imposer ses propres idées en studio face à un Terry Date qui affichait déjà un CV impressionnant. Cette fois, les cinq membres affichent clairement l’ambition d’évoluer et surtout de s’affirmer autrement qu’en simple clone de Korn. Around The Fur s’écrit et s’enregistre en deux mois seulement, sous le contrôle de leur producteur désormais attitré. Ce dernier capture parfaitement la nouvelle énergie du groupe en transformant complètement son esthétique : les frappes sèches et juvéniles du premier effort s’effacent au profit d’une lourdeur monolithique, urgente, dirigée par les tracés sinistres et réverbérés de Moreno.
On retient d'abord de ce deuxième album la portée générationnelle de ses deux singles phares. "My Own Summer (Shove It)" figure toujours parmi les titres les plus fédérateurs du groupe, avec toute cette colère froide retenue en un seul riff considérable. Au travers de ses reliefs vertigineux, le frontman révèle déjà une maîtrise déconcertante de ses différents registres, où fureur rime souvent avec sensualité. "Be quiet and drive" se distingue du reste de l’album par sa mélancolie nocturne et ses textures épaisses, hypnotiques, fuyant délibérément vers l’incertain : d’une certaine manière, la composition prédit les hallucinations urbaines de White Pony, ainsi que tout un pan du metal alternatif qui attendait encore d’être découvert.
Mais au-delà de ces deux monuments du genre, la régularité et la consistance d’Around The Fur impressionnent, en particulier la section rythmique qui consolide les fondations atypiques d’Adrenaline. Les motifs charismatiques du morceau éponyme démontrent la confiance absolue dont fait preuve le groupe envers sa nouvelle formule, que "Lhabia", "Rickets" et "Lotion" déroulent avec une intensité implacable. Il n’y a que le phrasé régressif de "Headup" qui ternit l’écoute, même s’il reste cohérent dans le contexte du disque et que la collaboration de Max Cavalera n’a rien de ridicule.
Dix albums plus tard, cet opus demeure comme la réalisation préférée de Chino Moreno sur toute sa carrière, et on comprend facilement pourquoi : la puissance de l’ensemble n’a pas vraiment d’équivalent dans le catalogue du groupe, et apparaît comme naturelle, aisée, spontanée. Le chanteur ne se souvient pas de conflits entre les différents musiciens durant cette période, mais d’une compétition positive qui a motivé chacun à se surpasser, à l’opposé des prochains cycles qui se révéleront parfois destructeurs. Le plaisir s’avère communicatif, puisque sans être le plus gros succès commercial du néo-metal à sa sortie, l’album influence pleinement la seconde vague de groupes, dont Linkin Park, et devient progressivement un classique moderne qui continue de vendre des milliers de copies dans le monde aujourd’hui. En plus de servir de clé de voûte du style Deftones, Around The Fur reste le meilleur album jamais produit pour ce genre, au sens strict du terme.
N°1 : White Pony (2000)

Vingt-cinq ans plus tard, la pièce maîtresse de Deftones n’a toujours pas trouvé de réel successeur. Probablement parce que sa fantaisie tient à la fois d’un alignement de planètes impossible à reproduire et d’une pulsion iconoclaste au mieux risquée, au pire irrationnelle.
La formation californienne aurait pu se faire une place de choix entre l’auto-titré de Slipknot, Significant Other de Limp Bizkit et Follow The Leader de Korn, qui ont collectivement propulsé le néo-metal en haut des charts quelques mois avant leur entrée en studio. Mais les musiciens se reconnaissent assez peu dans la direction artistique prise par les représentants de ce mouvement controversé. Sous l’influence d’Ok Computer de Radiohead et du travail de collage de DJ Shadow, ils se convainquent de leur capacité à développer leurs forces au-delà d’une recette alors maîtrisée.
Le processus créatif se réorganise autour de cette ambition, et le studio devient alors un outil d’expérimentation plutôt que la dernière étape du cycle. La transformation ne s’arrête pas là et touche la structure même du groupe jusque dans l’écriture, auparavant dirigée par Carpenter : Moreno s’oppose frontalement au style du guitariste et commence à apprendre la six-cordes lui-même, pour faciliter le bouleversement esthétique désiré : voilà le conflit au cœur de White Pony, celui qui rend l’écoute si particulière. Celui de Carpenter, architecte du néo-metal, contre ses camarades, qui préfèrent rêver de trip-hop et d’indépendance. Le tout sur fond de consommation de cocaïne, érigeant des montagnes vertigineuses en arrière-plan de ce poney blanc ...
À l’inverse du disque précédent, White Pony ne présente pas de formule claire d’un titre à l’autre, mais plutôt un tableau différent par composition, dont la cohérence ne tient qu’à un fil. Le ton de l’album, difficile à cerner, oscille entre la violence extrême, subie ("Feiticeira") comme commise ("Digital Bath"), et le délire charnel ("Knife Prty"). Les structures se contredisent sans cesse, des angles droits de "Elite" au progressisme de "Passenger", en passant par le crescendo glaçant de "Pink Maggit". Le frontman martyrise littéralement ses cordes vocales sur "Korea", alors qu’il gémissait doucement chaque syllabe quelques minutes plus tôt.
Alors d’où provient le liant ? De toute cette palette de couleurs négatives entretenue par un Terry Date sûr de lui, de ces coups de tonnerre assénés à tour de rôle par Moreno et Carpenter, de ces figures abstraites dessinées par le claviériste Frank Delgado fraîchement intégré au groupe, du caractère personnel de sa section rythmique, seul vestige de sanité sur tout le projet. L’intensité abrasive de White Pony s’apprécie surtout dans le contexte de l'œuvre entière¹, mais elle atteint des sommets sur le morbide "Digital Bath", semblable à un film d’horreur dont il est impossible de détourner le regard, puis sur "Knife Prty", avec la digression vocale incroyable d’une Rodleen Getsic possédée. Sans parler de "Change (in the house of flies)", et ses images de métamorphoses laissant planer le doute entre la laideur et la beauté, comme une mise en abîme du reste.
Le groupe met bien une décennie à se retrouver artistiquement à la suite de cette expérience, jugée dangereuse pour la survie du collectif et plus tard tenue responsable d’excès de confiance. Avec ce troisième opus, Deftones transcende un genre musical dont ils sont partiellement responsables. Aucun autre album du groupe n’égale cette richesse esthétique, qui marquera durablement le metal alternatif pour au moins deux décennies suivantes. En somme, un chef d’œuvre complet.
¹ Si on évite "Back To School (Mini Maggit)", single forcé et monté de toute pièce par le label qui craignait des performances commerciales désastreuses, absent des copies originelles mais désormais collé en introduction sur les services de streaming.